L’approche pluridisciplinaire des démarches artistiques et critiques a tout lieu de s’enrichir d’initiatives telles que celle qui a eu lieu en juillet 2000 à l’occasion de la venue du danseur et chorégraphe Min Tanaka au SMAK (Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst) de Gand. Une œuvre puissante, éphémère et quasi anonyme s’est manifestée dans cette conjonction qui a eu lieu alors entre danse, arts visuels et vidéo, dans une synergie recréant chacune des disciplines invoquées – et dont les enjeux concernent le champ esthétique contemporain dans son ensemble. En se penchant sur ce travail, Tausend Augen poursuit ses investigations esthétiques qui, à partir du cinéma qui reste un ancrage important, nous amènent pourtant petit à petit à interroger un champ artistique et culturel de plus en plus large. Nous proposons donc à nos lecteurs de trouver, comme nous l’avons fait dans un domaine que nous abordons pour la première fois – la danse, dans une configuration complexe – la même dimension d’émotion artistique et de réflexion qu’ils accordent ordinairement à l’image en mouvement – laquelle n’est d’ailleurs pas absente de nos propos.
Min Tanaka et le butoh
 Min Tanaka est un des représentants les plus illustres du butoh, courant de danse contemporaine né au Japon dans les années cinquante sur l'initiative de Tatsumi Hijikata – dont l’influence est primordiale pour Tanaka – et du toujours actif et réputé, malgré son statut de nonagénaire, Kazuo Ohno. Le butoh apparaît dans le Japon détruit par la guerre et occupé par les Etats-Unis, un pays dont la culture en pleine mutation après des siècles d’isolation est asservie à l’Occident victorieux. Pour une génération d’artistes opérant dans différents champs artistiques – les plus connus en Occident sont Yukio Mishima en littérature ou les plasticiens du groupe Gutai –, il est impératif de recréer des formes artistiques échappant à la fois aux schémas de la vieille culture japonaise impériale définitivement discréditée par l’alliance avec les nazis et la défaite, mais aussi aux diktats de la culture de l’ennemi, classique ou moderne.
Min Tanaka est un des représentants les plus illustres du butoh, courant de danse contemporaine né au Japon dans les années cinquante sur l'initiative de Tatsumi Hijikata – dont l’influence est primordiale pour Tanaka – et du toujours actif et réputé, malgré son statut de nonagénaire, Kazuo Ohno. Le butoh apparaît dans le Japon détruit par la guerre et occupé par les Etats-Unis, un pays dont la culture en pleine mutation après des siècles d’isolation est asservie à l’Occident victorieux. Pour une génération d’artistes opérant dans différents champs artistiques – les plus connus en Occident sont Yukio Mishima en littérature ou les plasticiens du groupe Gutai –, il est impératif de recréer des formes artistiques échappant à la fois aux schémas de la vieille culture japonaise impériale définitivement discréditée par l’alliance avec les nazis et la défaite, mais aussi aux diktats de la culture de l’ennemi, classique ou moderne.Pour le danseur Tatsumi Hijikata, les propositions d’investigation de la modernité permettent de fonder une nouvelle forme de danse ne devant rien aux courants dominants de l’époque tout en répondant aux enjeux de ce qui est encore alors la logique de l’avant-garde. Héritière de la danse expressionniste allemande dans ses recherches les plus avancées – quand Mary Wigman, par exemple, fuyant le nazisme comme énormément d’artistes européens, a laissé sa danse s’affadir dans le contexte américain –, mais nourrie aussi, dans une recherche primitiviste, des danses traditionnelles ainu – ethnie opprimée occupant initialement le Japon et acculée dans le nord du pays, dans l’île d’Hokkaido –, ce qui est encore alors l’ankoku butoh, la danse des ténèbres comme la nomme Hijikata, se caractérise notamment par l’exploitation d’éléments physiques inusités par la danse occidentale.
 Les notions, implicitement associées à la danse, de grâce, d’envol, de légèreté, de contrôle, d’aisance, de beauté sont dénoncées comme purement conventionnelles, et le butoh va s’attaquer au corps réel, aux mouvements fondamentaux, à la présence entière du danseur dansant, réalisant en danse le travail de modernité déjà en œuvre dans les arts plastiques ou la musique. Influencé aussi par Artaud, Sade ou Bataille, Hijikata redéfinit un érotisme primordial, violent, élémentaire, et affirme le projet subversif de s’attaquer à l’aliénation par le travail dans le système capitaliste là où elle se porte en premier lieu, c'est-à-dire sur le corps même du travailleur, la force de travail réelle dans son aspect le plus concret.
Les notions, implicitement associées à la danse, de grâce, d’envol, de légèreté, de contrôle, d’aisance, de beauté sont dénoncées comme purement conventionnelles, et le butoh va s’attaquer au corps réel, aux mouvements fondamentaux, à la présence entière du danseur dansant, réalisant en danse le travail de modernité déjà en œuvre dans les arts plastiques ou la musique. Influencé aussi par Artaud, Sade ou Bataille, Hijikata redéfinit un érotisme primordial, violent, élémentaire, et affirme le projet subversif de s’attaquer à l’aliénation par le travail dans le système capitaliste là où elle se porte en premier lieu, c'est-à-dire sur le corps même du travailleur, la force de travail réelle dans son aspect le plus concret. Min Tanaka a, entre autres, récemment créé une nouvelle compagnie, Tokason Butoh Group, qui vient de terminer une tournée internationale avec leur nouveau spectacle Romance. Entre PS1 à New York et la Villa Médicis à Rome, il s’est arrêté une semaine à Gand sur l’invitation d’Emilie de Vlam, danseuse et responsable de l’association MA, semaine au cours de laquelle, outre deux représentations de Romance au SMAK et l’encadrement d’un stage exceptionnel de cinq jours pour des danseurs venus de toute l’Europe, lui et ses danseurs ont montré plusieurs spectacles de rue en groupe ou en solo dans le cadre du Festival International de Théâtre de Rue de Gand, une représentation de Fire Story à l’Abbaye Sint Baas, et quatre improvisations de Tanaka au SMAK à partir de quatre œuvres des collections ou exposées temporairement.
Min Tanaka a, entre autres, récemment créé une nouvelle compagnie, Tokason Butoh Group, qui vient de terminer une tournée internationale avec leur nouveau spectacle Romance. Entre PS1 à New York et la Villa Médicis à Rome, il s’est arrêté une semaine à Gand sur l’invitation d’Emilie de Vlam, danseuse et responsable de l’association MA, semaine au cours de laquelle, outre deux représentations de Romance au SMAK et l’encadrement d’un stage exceptionnel de cinq jours pour des danseurs venus de toute l’Europe, lui et ses danseurs ont montré plusieurs spectacles de rue en groupe ou en solo dans le cadre du Festival International de Théâtre de Rue de Gand, une représentation de Fire Story à l’Abbaye Sint Baas, et quatre improvisations de Tanaka au SMAK à partir de quatre œuvres des collections ou exposées temporairement.Conjonction artistique à Gand, Belgique
Une coïncidence a fait qu'Appel et Serra, amis et collaborateurs de Tanaka1, exposaient tous deux au SMAK dans la période de sa présence, ce qui a initié le projet de rencontre entre danse et arts plastiques dans l’espace muséal. Sur une proposition de Jan Hoet, directeur du SMAK, Tanaka a étendu ce projet à deux œuvres importantes de la collection du musée gantois, Wirtschaftswerte de Joseph Beuys et die toillette de Ilya Kabakof. Ces quatre improvisations ont été présentées dans l’après-midi du 24 juillet 2000, en présence de Karel Appel. La disposition des installations de Beuys et Kabakof limitant leur accès au public pendant le temps des performances2, il a été décidé d’avoir recours à la vidéo pour permettre au public d’assister en direct sur un moniteur aux moments pendant lesquels le danseur échappait à leur regard : ainsi s’est mis en place un dispositif multimédia permettant la rencontre à différents niveaux d’artistes qui, tout en œuvrant chacun dans son domaine propre, devenaient les acteurs d’une création collective, et amena les spectateurs à réenvisager chacun des éléments proposés selon les perspectives d’une nouvelle mise en espace3 : ce sont ces performances même qui nous intéressent tout particulièrement ici.
Cette rencontre est loin d’être anecdotique ou de ne valoir que par les grands noms des artistes y participant : elle semble tout à fait indispensable, et elle fonde – ou refonde, car tel est la grandeur et la servitude des arts expérimentaux de devoir réitérer leurs expériences jusqu’à ce qu’elles soient reconnues et acceptées – une discipline protéiforme et totale de recherche esthétique dont le matériau de base est l’expérience. Rares sont les artistes que la reconnaissance publique ne vitrifie pas dans un fétichisme vidant le rapport réel de l’œuvre avec son public pour y substituer une nébulosité d’informations extérieures qu’il faudrait avoir digérées complètement avant de retrouver la candeur du premier contact – quand c’est encore possible : très souvent il ne reste qu’un simulacre, une trace laissée en creux dans le brouillard/brouillage... Avez-vous été empêchés de marcher sur une sculpture plane de Carl André dans un grand musée parisien ? Avez-vous regardé une œuvre participative de Lygia Clark enfermée dans une vitrine avec, à côté de son cartel, une photo explicative d’une utilisation par le public désormais impossible ? Avez-vous dansé dans une installation de Kabakof ?
 Être naïvement idéaliste et chercher une quelconque perfection de l’art dans son système de production et de diffusion ne peut produire qu’un romantique aveuglement qui n’est plus de mise à notre stade de modernité (on ne devrait plus tarder à être débarrassé du fantasmatique postmodernisme que certains utilisent encore pour le qualifier, voire le définir). Allons chercher et vivons l’expérience là où elle peut exister, comme elle peut exister. Joseph Beuys ne conçoit pas une installation comme Wirtschaftswerte pour qu’elle se délite dans l’ambiance de zoo d’un musée, il la crie comme un discours de matières et d’images, il la jette comme un caillou dans les engrenages de l’immense système de création de sens – dont il fait désormais partie, et ce caillou devient engrenage lui aussi, et son discours est posé sur une étagère. Mais le même romantisme moderne pourrait nous laisser désespérer de ne voir de fauves qu’en cage, si Beuys n’avait en fait très consciemment travaillé avec la matière même du musée4, comme il a travaillé avec la matière même de l’art, de l’enseignement, de la politique : c’est ce qui en fait un artiste de sa trempe et le laisse vierge des admirations les plus compromettantes.
Être naïvement idéaliste et chercher une quelconque perfection de l’art dans son système de production et de diffusion ne peut produire qu’un romantique aveuglement qui n’est plus de mise à notre stade de modernité (on ne devrait plus tarder à être débarrassé du fantasmatique postmodernisme que certains utilisent encore pour le qualifier, voire le définir). Allons chercher et vivons l’expérience là où elle peut exister, comme elle peut exister. Joseph Beuys ne conçoit pas une installation comme Wirtschaftswerte pour qu’elle se délite dans l’ambiance de zoo d’un musée, il la crie comme un discours de matières et d’images, il la jette comme un caillou dans les engrenages de l’immense système de création de sens – dont il fait désormais partie, et ce caillou devient engrenage lui aussi, et son discours est posé sur une étagère. Mais le même romantisme moderne pourrait nous laisser désespérer de ne voir de fauves qu’en cage, si Beuys n’avait en fait très consciemment travaillé avec la matière même du musée4, comme il a travaillé avec la matière même de l’art, de l’enseignement, de la politique : c’est ce qui en fait un artiste de sa trempe et le laisse vierge des admirations les plus compromettantes.C’est aussi ce que danse Min Tanaka : la matière même de l’expérience. Sa danse se fonde sur son assimilation de l’espace, l’offrande qu’il en fait à son corps et l’offrande que son corps en fait. Si vous vous joignez à la compagnie de Tanaka pour recevoir son enseignement, vous vous retrouvez dans une ferme dans la montagne à quelques heures de train au sud-ouest de Tokyo – la Body Weather Farm –, et dans votre emploi du temps pour quelques semaines, il y a un entraînement très physique et rigoureux, un travail d’expériences sensorielles à la recherche de la propre danse de chacun, et puis le travail de la ferme proprement dit. Tous les ouvriers agricoles sont aussi des danseurs, et réciproquement – et cela sans folklore, mais de façon très pragmatique. Rien à voir avec un quelconque retour à la nature, vous êtes ici pour la danse, la vraie danse, qui ne consiste pas à reproduire des mouvements étiquetés comme mouvements de danse, mais doit être créée par chacun à l’aide de la plus vaste banque de mouvements qui soit, celle des mouvements du travail agricole : telle est la proposition de Tanaka. Elle est aussi de développer une conscience de l’espace qui crée une danse spécifique pour chaque danseur, lui-même dans la spécificité de son corps et de son vécu, avec une sensibilité particulière à la nature dans sa complexité – sensibilité qui devient génie quand elle se confronte au travail artistique5.
Tanaka, Beuys, Kabakof + vidéo
 Min Tanaka dansant un espace défini par Joseph Beuys par des objets/images/matières lisibles et ressentis à tant de différents niveaux n’en donne pas une interprétation, il invente – au sens des découvreurs de trésors – ce que Beuys n’y a pas mis mais dans son paradigme même, avec cette possibilité unique et incroyable de nier ouvertement le choix définitif de l’artiste pourtant essentiel dans sa démarche, pour actualiser le temps de la performance une tempête de potentiels et de virtualités. C’est-à-dire qu’il entreprend physiquement le travail mental du spectateur actif, tout en participant de la nature concrète de l’œuvre, sa plasticité, son adresse aux sens, et aussi de sa nature intellectuelle, dans sa demande de vigilance, l’attention qu’il requiert, qu’il provoque, qu’il fixe – un instant. Bref, il rouvre l’œuvre en en devenant la mesure humaine, quand réciproquement elle lui offre une combinaison de danse inédite, complexe, à sa mesure – certainement pas un décor, mais véritablement un partenaire comme le sont les danseurs avec qui il peut partager une scène. Et comme il s’en crée un avec un cadreur vidéo : l’installation de Beuys est dans une pièce réduite et l’accès en est limité, aussi y a-t-il un moniteur à l’extérieur pour une partie du public, et aussi Tanaka partage-t-il l’espace avec un autre corps qui en l’occurrence se meut mais ne danse pas, quelque chose d’un coyote ou d’un lièvre mort6.
Min Tanaka dansant un espace défini par Joseph Beuys par des objets/images/matières lisibles et ressentis à tant de différents niveaux n’en donne pas une interprétation, il invente – au sens des découvreurs de trésors – ce que Beuys n’y a pas mis mais dans son paradigme même, avec cette possibilité unique et incroyable de nier ouvertement le choix définitif de l’artiste pourtant essentiel dans sa démarche, pour actualiser le temps de la performance une tempête de potentiels et de virtualités. C’est-à-dire qu’il entreprend physiquement le travail mental du spectateur actif, tout en participant de la nature concrète de l’œuvre, sa plasticité, son adresse aux sens, et aussi de sa nature intellectuelle, dans sa demande de vigilance, l’attention qu’il requiert, qu’il provoque, qu’il fixe – un instant. Bref, il rouvre l’œuvre en en devenant la mesure humaine, quand réciproquement elle lui offre une combinaison de danse inédite, complexe, à sa mesure – certainement pas un décor, mais véritablement un partenaire comme le sont les danseurs avec qui il peut partager une scène. Et comme il s’en crée un avec un cadreur vidéo : l’installation de Beuys est dans une pièce réduite et l’accès en est limité, aussi y a-t-il un moniteur à l’extérieur pour une partie du public, et aussi Tanaka partage-t-il l’espace avec un autre corps qui en l’occurrence se meut mais ne danse pas, quelque chose d’un coyote ou d’un lièvre mort6.Le cadreur est à la fois un super et un sous-spectateur. Mais celui-ci, particulièrement parmi d’autres qui immanquablement ont sorti leur caméra et filment aussi, est surtout dans l’espace de vision des spectateurs qui ne regardent pas l’écran, il n’est pas non plus comme si souvent le réel parasite de l’événement, mais aspiré, avec les images qu’il produit, par l’œuvre danse/installation qui lui ordonne d’être. Il est le pendant spatial, conceptuel et historique des portraits des bourgeois compassés du dix-neuvième siècle convoqués par Beuys, il sur-référencie le spectacle du 21ème siècle dans son ordinaire et son extraordinaire comme Tanaka et Beuys en balisent eux aussi les limites. Eux aussi, eux quand même, eux malgré tout, car ce ne sont guère les artistes qui définissent encore la perception du réel comme ce peut, ce doit être leur rôle, ou pas directement, pas avant d’avoir été pillé par les recycleurs et réducteurs d’idées qui nourrissent les médias. Mais une fois encore, inutile de pleurnicher sur l’étroite voie permise à l’art entre son propre réseau sclérosé et le monopole politico-commercial des médias : il faut au contraire intégrer cela à notre perception et notre intelligence de l’art contemporain, c’en est un paramètre important. Ce n’est pas par hasard que Min Tanaka s’affronte dans cette recherche à l’image vidéographique, et qu’il le fait dans cette relation triangulaire danse/installation/vidéo.

Tanaka et ses danseurs se méfient dans l’ensemble des images mécaniques du butoh et de son esthétisation qui en pervertit l’esprit originel – et qui fait la renommée de Sankai Juku par exemple (c’est pourquoi les photos accompagnant cet article ainsi que le portfolio qui le suit sont assez exceptionnelles !). S’il danse dans son fief d’Hakushu ou à Plan B, cette petite salle alternative de Tokyo où il se produit toujours régulièrement, il évitera photographes et vidéastes, même si lui-même documente et archive soigneusement son travail. Mais l’espace du SMAK, tout particulièrement celui-là, bastion du très médiatique Jan Hoet – notamment curateur de la Documenta IX –, dépasse de loin les trois dimensions physiques, ainsi que les œuvres y paraissant : diffusées sous toutes les formes photographiques et vidéographiques, via les catalogues, les plaquettes, les monographies, les cartes postales, les émissions télévisées, les documentaires, etc., elles appartiennent de plein droit à l’espace virtuel de l’information. Cela, même le très concret Tanaka dont la danse s’ancre dans le réel de l’espace et du corps plus que toute autre, ne peut l’ignorer.
Dès lors, il met en coïncidence les différents régimes d’espaces, mentaux autant que dimensionnels, tels qu’ils sont proposés par l’installation, par la danse et par leur mise en information par la vidéo. Dans l’improvisation qu’il propose pour l’installation d’Ilya Kabakof7, il commence à l’extérieur, devant un mur blanc, face aux spectateurs, à côté du moniteur diffusant sa propre image captée par le cadreur situé dans le même espace que lui : tous les acteurs sont réunis – public y compris. Dans cette longue et lente première partie, il balise l’espace, le mur, le sol, sa silhouette noire confrontée au blanc de l’espace insiste sur la dimension soigneusement graphique de la prestation – cela est encore accentué dans la vidéo qui propose une vue latérale ; dans l’espace conventionnellement neutre du musée, les anecdotes dont il semble tirer sa danse peuvent être les spectateurs eux-mêmes, certains entrent même dans le champ de la caméra. Ce public peut à chaque instant assister à la confrontation entre corps dansant et espace tridimensionnel et leur réduction vidéographique, leur recadrage, leur codage informationnel. Plusieurs fois, Tanaka se tient très près du moniteur dont l’écran entre dans le cadre, provoquant un effet de larsen désignant bien la matière électronique même de la vidéo.
 Puis, toujours lentement, le danseur se dirige vers une des portes de l’installation dans laquelle il pénètre, suivi par la caméra, c’est par l’intermédiaire de celle-ci qu’il continue à s’adresser à un public resté à l’extérieur et qui maintenant se retrouve dans cette posture si familière du téléspectateur, mais avec – il faut l’espérer – une autre conscience d’une image authentiquement indicielle – parce qu’il faut ordinairement en douter – et de la réelle distance avec la réalité qu’il a pu littéralement vérifier. D’autant plus que Tanaka a changé de registre : l’espace s’est concentré autour de lui, saturé des babioles accumulées par Kabakof, dans cet étrange état de stase narrative caractérisant le travail de l’artiste russe et qui va maintenant posséder le danseur dans un micro-drame télévisé. L’espace condensé du moniteur est alors un réceptacle adéquat pour cette danse redensifiée, alors qu’un nouvel espace entre réel et média se crée dans la conjonction entre le visuel étrangement décalé d’une danse légèrement mais radicalement différée dans l’espace, hors de vue mais visible autrement, et le sonore qui reste direct – Tanaka bouscule meubles et objets, fait grincer portes et lits dans sa brusque tragi-comédie qui, comme cela avait été le cas auparavant avec Beuys, le fait autant trahir que confirmer Kabakof dans son jeu ambigu du potentiel. Puis le danseur soudain s’apaise, se tourne simplement vers la caméra dans un geste de profonde maîtrise de ce qu’il a bien voulu lui accorder et salue le public – toujours à quelques mètres et toujours invisible, mais avec qui le contact est resté entier, et qui se manifeste en bouclant le double jeu image/son par ses applaudissements.
Puis, toujours lentement, le danseur se dirige vers une des portes de l’installation dans laquelle il pénètre, suivi par la caméra, c’est par l’intermédiaire de celle-ci qu’il continue à s’adresser à un public resté à l’extérieur et qui maintenant se retrouve dans cette posture si familière du téléspectateur, mais avec – il faut l’espérer – une autre conscience d’une image authentiquement indicielle – parce qu’il faut ordinairement en douter – et de la réelle distance avec la réalité qu’il a pu littéralement vérifier. D’autant plus que Tanaka a changé de registre : l’espace s’est concentré autour de lui, saturé des babioles accumulées par Kabakof, dans cet étrange état de stase narrative caractérisant le travail de l’artiste russe et qui va maintenant posséder le danseur dans un micro-drame télévisé. L’espace condensé du moniteur est alors un réceptacle adéquat pour cette danse redensifiée, alors qu’un nouvel espace entre réel et média se crée dans la conjonction entre le visuel étrangement décalé d’une danse légèrement mais radicalement différée dans l’espace, hors de vue mais visible autrement, et le sonore qui reste direct – Tanaka bouscule meubles et objets, fait grincer portes et lits dans sa brusque tragi-comédie qui, comme cela avait été le cas auparavant avec Beuys, le fait autant trahir que confirmer Kabakof dans son jeu ambigu du potentiel. Puis le danseur soudain s’apaise, se tourne simplement vers la caméra dans un geste de profonde maîtrise de ce qu’il a bien voulu lui accorder et salue le public – toujours à quelques mètres et toujours invisible, mais avec qui le contact est resté entier, et qui se manifeste en bouclant le double jeu image/son par ses applaudissements.Pertinence de l’expérience

La culture contemporaine est en un certain sens facilement analysable dans ses aspects très concrets de production et de diffusion, de par leur dimension technologique : ce qui échappe à la stricte mécanique des médias semble dérisoire. Rien apparemment qui ne soit rigoureusement fabriqué selon des procédés éprouvés, et dans des objectifs sinon avoués car inavouables, pour autant assez clairs, de l’autoglorification permanente du système éprouvé du médiatique et du capitaliste ; et ce qui passe par la télévision, est publié par la presse ou utilise tout autre média technologique ne peut clairement l’être qu’avec l’approbation de leurs propriétaires. Ce qui par extraordinaire arrive à se faufiler fortuitement dans le système est immanquablement réduit à un format qui en fin de compte le différencie difficilement du reste, et il faut admettre que ce qui n’utilise pas ce réseau est infime dans le flot d’information médiatique auquel il doit se mesurer. Pour rester acteur dans cette société, il semble indispensable de se positionner par rapport à cela, il serait illusoire de se vouloir neutre, de se tenir à l’écart. Tenir un discours sur le corps demande de l’appréhender aussi dans sa dimension mentale, et celle-ci est soumise à l’heure actuelle à une exceptionnelle pression médiatique : il ne semble pas impensable qu’en une journée on ait affaire à plus d’images de corps – photographiés ou filmés – qu’à des corps réels. Et ces images sont fortement orientées, elles ne sont pas reproductions de la réalité – d’ailleurs, pourquoi existeraient-elles si c’était le cas ? –, mais s’attribuent un niveau supérieur de réalité, celui du médiatique, et amènent alors à une conception décalée, inadaptée, inconfortable, du corps et donc du soi : qui peut résister à cela ?
 Le travail du butoh et particulièrement celui de Min Tanaka – et ce pourrait être celui de toute forme de danse qui se revendique d’une démarche artistique – est un travail de libération du corps, dans le maximum de sens du terme. En alliant la puissance cathartique héritée des sources les plus primitives de la danse aux procès et intentions d’une démarche toujours radicalement contemporaine, Tanaka questionne inlassablement le corps avec la puissance de son médium et de sa pratique qui incarnent véritablement ce questionnement, le traduisent directement en influx nerveux, en réactions musculaires, en perceptions proprioceptives injectés dans le corps même du spectateur et qui rendent indiscutables la nécessité et l’impact de ce travail, ancrant tous les corrélats intellectuels qui ne manquent pas de surgir dans le plus concret du ressenti. Mais peut-il se mesurer aux corps apparemment omnipotents8, en images, des mannequins, sportifs, justiciers et autres surhommes qui, dans leur représentation continuelle, peuplent les écrans et les imaginaires ? Si son champ et sa force sont la réalité, il ne peut ignorer le réel du médiatique, et sait aller chercher ses adversaires sur leur propre terrain à deux dimensions : en s’introduisant dans l’espace muséal, plastique et artistique, puis dans celui informationnel de l’image électronique, Tanaka parcourt et unifie ces espaces pour qu’en un certain sens la réalité reprenne ses droits, que tout se retrouve mesurable à l’aune de l’expérience qu’il propose et qui est celle de tous, celle du corps, celle d’être dans l’espace en pleine conscience, celle de s’associer aux autres expériences de l’art ou des médias, de les apprécier et de les juger, de les transmettre sous de nouvelles formes mais au même niveau. C’est ainsi que, suivant la formule de Beuys, tout le monde est un artiste : en s’octroyant une valeur d’expérience personnelle à partir d’une œuvre qui devient aussi légitime que l’œuvre elle-même, et c’est ce qui valide l’art.
Le travail du butoh et particulièrement celui de Min Tanaka – et ce pourrait être celui de toute forme de danse qui se revendique d’une démarche artistique – est un travail de libération du corps, dans le maximum de sens du terme. En alliant la puissance cathartique héritée des sources les plus primitives de la danse aux procès et intentions d’une démarche toujours radicalement contemporaine, Tanaka questionne inlassablement le corps avec la puissance de son médium et de sa pratique qui incarnent véritablement ce questionnement, le traduisent directement en influx nerveux, en réactions musculaires, en perceptions proprioceptives injectés dans le corps même du spectateur et qui rendent indiscutables la nécessité et l’impact de ce travail, ancrant tous les corrélats intellectuels qui ne manquent pas de surgir dans le plus concret du ressenti. Mais peut-il se mesurer aux corps apparemment omnipotents8, en images, des mannequins, sportifs, justiciers et autres surhommes qui, dans leur représentation continuelle, peuplent les écrans et les imaginaires ? Si son champ et sa force sont la réalité, il ne peut ignorer le réel du médiatique, et sait aller chercher ses adversaires sur leur propre terrain à deux dimensions : en s’introduisant dans l’espace muséal, plastique et artistique, puis dans celui informationnel de l’image électronique, Tanaka parcourt et unifie ces espaces pour qu’en un certain sens la réalité reprenne ses droits, que tout se retrouve mesurable à l’aune de l’expérience qu’il propose et qui est celle de tous, celle du corps, celle d’être dans l’espace en pleine conscience, celle de s’associer aux autres expériences de l’art ou des médias, de les apprécier et de les juger, de les transmettre sous de nouvelles formes mais au même niveau. C’est ainsi que, suivant la formule de Beuys, tout le monde est un artiste : en s’octroyant une valeur d’expérience personnelle à partir d’une œuvre qui devient aussi légitime que l’œuvre elle-même, et c’est ce qui valide l’art.



/image%2F1462857%2F20221211%2Fob_25c91f_ob-25926c-avion.jpg)


/image%2F1462857%2F20201231%2Fob_8d7b1d_download.jpg)
/image%2F1462857%2F20210113%2Fob_d1b138_img-0148.jpg)
/image%2F1462857%2F20210115%2Fob_326f6f_image-1462857-20210113-ob-74a3de-corps.jpg)
/image%2F1462857%2F20210115%2Fob_7440bb_papiers-timbre-s-120.jpg)
/image%2F1462857%2F20210115%2Fob_c4fbad_img-6378.jpeg)








 Min Tanaka explique sa philosophie de la danse en ces termes : « Sur scène, on se sent comme dans un jardin. Habituellement, on s’attend à ce que les danseurs suivent à la lettre les directives d’un chorégraphe. Mais quelque part dans mon esprit, j’attends toujours qu’ils bousculent ma chorégraphie. Il me semble qu’à l’origine, la danse devait ressembler à cela. Bien entendu, nous avons une sorte de contrat, dans la mesure où nous établissons, dans le cadre du processus de création, qui entre avant qui, à quel moment, etc. Néanmoins, je n’ai pas d’objection à ce qu’un danseur ou une danseuse puisse, à tout moment, décomposer la chorégraphie s’il ou elle possède une raison valable et authentique d’agir ainsi. Le lieu, la scène, devrait être davantage un espace de liberté que ne le suppose sa destination d’origine. Voire même un espace d’anarchie. Toutefois, le changement ou la déviation doit partir d’une réelle nécessité intérieure de l’interprète. Il ne suffit pas de recourir à une astuce ou une tactique délibérée; ça ne fonctionne pas ainsi. (…) Je n’ai pas coutume de me lancer dans des méditations purement cosmiques; je préfère partir de ce côté-ci du réel pour élargir peu à peu jusqu’au cosmos. Même s’il est couramment admis que l’univers existe autour de nous, il n’est pas si simple d’en ressentir physiquement la présence. »
Min Tanaka explique sa philosophie de la danse en ces termes : « Sur scène, on se sent comme dans un jardin. Habituellement, on s’attend à ce que les danseurs suivent à la lettre les directives d’un chorégraphe. Mais quelque part dans mon esprit, j’attends toujours qu’ils bousculent ma chorégraphie. Il me semble qu’à l’origine, la danse devait ressembler à cela. Bien entendu, nous avons une sorte de contrat, dans la mesure où nous établissons, dans le cadre du processus de création, qui entre avant qui, à quel moment, etc. Néanmoins, je n’ai pas d’objection à ce qu’un danseur ou une danseuse puisse, à tout moment, décomposer la chorégraphie s’il ou elle possède une raison valable et authentique d’agir ainsi. Le lieu, la scène, devrait être davantage un espace de liberté que ne le suppose sa destination d’origine. Voire même un espace d’anarchie. Toutefois, le changement ou la déviation doit partir d’une réelle nécessité intérieure de l’interprète. Il ne suffit pas de recourir à une astuce ou une tactique délibérée; ça ne fonctionne pas ainsi. (…) Je n’ai pas coutume de me lancer dans des méditations purement cosmiques; je préfère partir de ce côté-ci du réel pour élargir peu à peu jusqu’au cosmos. Même s’il est couramment admis que l’univers existe autour de nous, il n’est pas si simple d’en ressentir physiquement la présence. »






/image%2F1462857%2F20201231%2Fob_923107_134436456-4245850898781379-88712819336.jpg)


/image%2F1462857%2F20210113%2Fob_e0782e_dsc5934.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FBXLWIaEqxs8%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F1462857%2F20201231%2Fob_651ec4_90471593-10218920421295714-26007026974.jpg)
/image%2F1462857%2F20201231%2Fob_fd1a95_50502957-2454657694567384-123080034269.jpg)
/image%2F1462857%2F20210113%2Fob_d6bd92_5e7c8cdd-b13c-45ce-8833-ae3d9cc7b0f4.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_3d6432_img-1482.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_cc5fe5_img-1751.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_168786_img-9111.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_0130d6_img-9123.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_a54dba_img-2274.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_1edb69_img-2261.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_80db41_img-2264.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_f9a4d1_img-1788.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_ff7922_img-1487.jpg)
/image%2F1462857%2F20160617%2Fob_219b70_img-9088.jpg)
/image%2F1462857%2F20190309%2Fob_4abd79_50728453-2452172978149189-165706637642.jpg)
/image%2F1462857%2F20190309%2Fob_ca2c19_36566693-2118862348146922-215610510335.jpg)
/image%2F1462857%2F20201227%2Fob_1f3274_img-0681.jpeg)

/image%2F1462857%2F20210113%2Fob_ac266d_img-0445.jpg)
/image%2F1462857%2F20210113%2Fob_d29546_img-1135.jpg)
/image%2F1462857%2F20210701%2Fob_a14bbc_208312732-1179271142496764-65183124887.jpg)
/image%2F1462857%2F20210701%2Fob_e135be_210410231-504769304095390-539018985365.jpg)
/image%2F1462857%2F20210701%2Fob_80ec9c_209310447-345165157132240-813993776447.jpg)
/image%2F1462857%2F20210701%2Fob_011087_208641828-802942043922054-146776650198.jpg)
/image%2F1462857%2F20210701%2Fob_2604ce_208508187-539556830504199-247651493773.jpg)
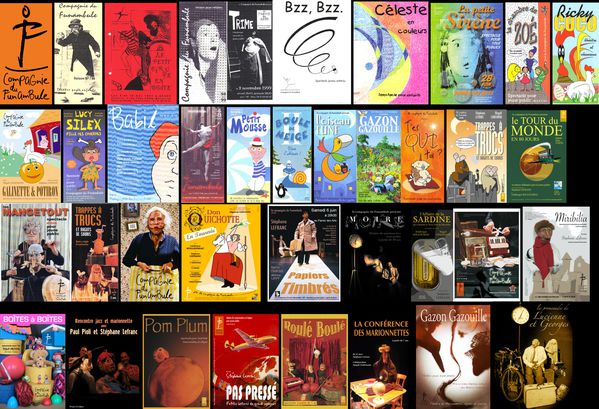
/image%2F1462857%2F20221220%2Fob_127407_affiche-boeuf-web.jpg)
/image%2F1462857%2F20210209%2Fob_89f46b_img-0409.jpg)
/image%2F1462857%2F20210209%2Fob_6bbe0b_mario-couleurs-131.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_60beb0_boeuf-1.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_2b894c_boeuf-23.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FiVg5cNefzdA%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_53d10e_boeuf-39.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_391e06_boeuf-44.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_67fe51_boeuf-92.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_741f70_boeuf-101.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_57a295_boeuf-69.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_8bec2e_boeuf-80.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_7060dd_boeuf-120.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_c52620_boeuf-135.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_053222_boeuf-154.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_8c3e55_boeuf-163.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_0e2b58_boeuf-174.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_dacb9c_mario-couleurs-7.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_40024c_boeuf-23.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_50508e_boeuf-27.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_9232f7_img-0532.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_51922d_mario-couleurs-45.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_124cfa_mario-couleurs-48.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_1e714f_mario-couleurs-50.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_8380e7_mario-couleurs-60.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_d4bd3c_mario-couleurs-61.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_1a136e_mario-couleurs-71.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_4ccfb6_img-0551.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_d76e95_img-0538.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_baf698_mario-couleurs-83.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_69b9e2_img-0544.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_4d4007_mario-couleurs-89.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_df1764_img-0534.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_48df7d_mario-couleurs-98.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_1ccd5b_img-0535.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_3d0c5a_mario-couleurs-112.jpg)
/image%2F1462857%2F20220317%2Fob_5bb199_mario-couleurs-131.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_25da04_img-0537.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_d4cdc1_img-0553.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_20b47c_img-0540.jpg)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_c3c364_capture-d-e-cran-2017-01-23-a-18.png)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_3b6a99_capture-d-e-cran-2017-01-23-a-18.png)
/image%2F1462857%2F20220501%2Fob_82515a_capture-d-e-cran-2017-01-23-a-18.png)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FtzCkDNCM3R4%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F1462857%2F20211023%2Fob_d68943_capture-d-e-cran-2021-10-23-a-09.png)